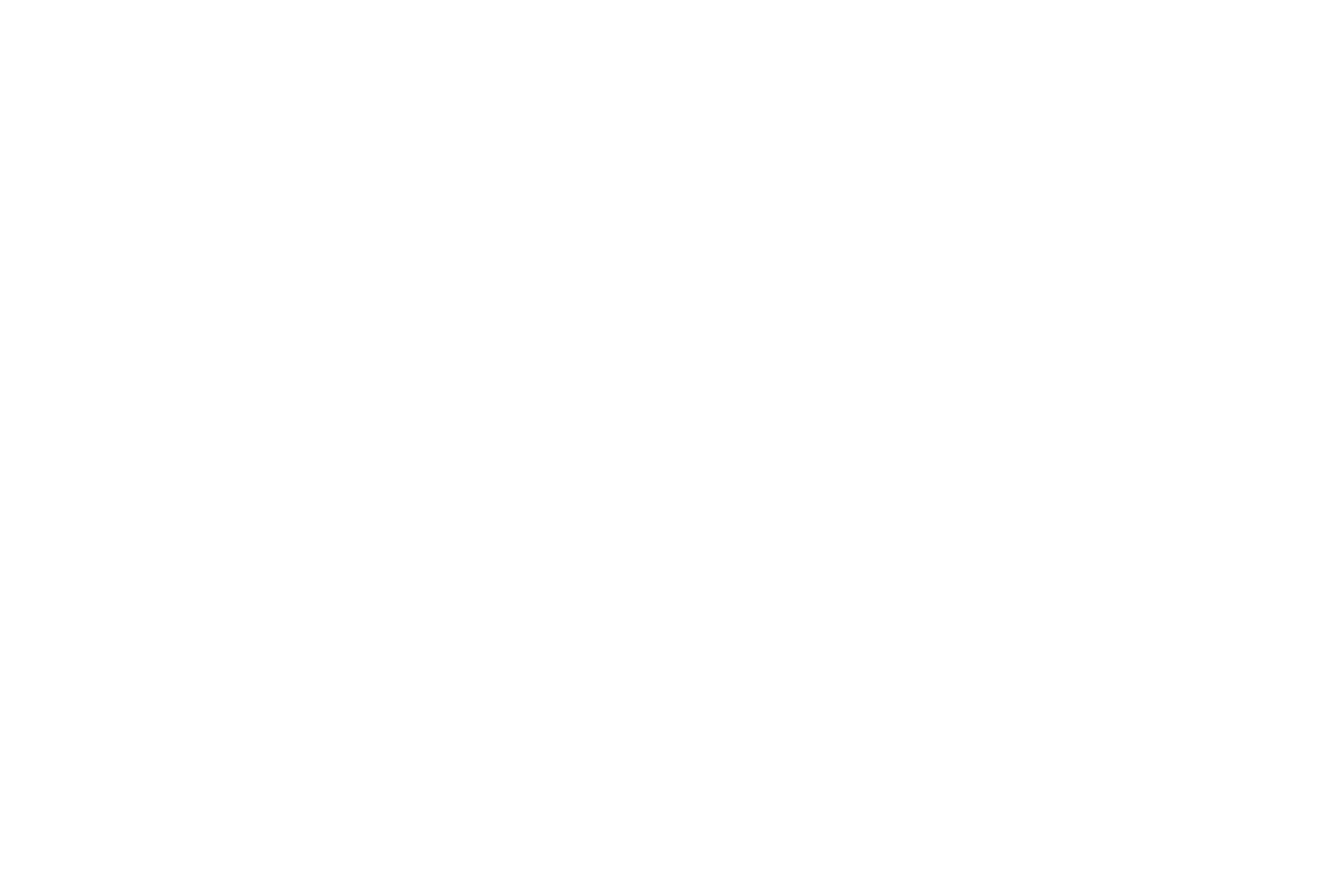« Pour devenir un homme comme ton père, tu dois être circoncis mon fils. » est la phrase qu’elle me répétait ma mère quand j’avais atteint l’âge de quatre ou cinq ans.
Pour me rassurer, elle enchainait :
— Tu verras mon chéri, ça ne va pas te faire mal, ton coiffeur, Monsieur Lahbib, a des doigts de fée, il le fait très bien et avec des ciseaux en bonbon.
Le coiffeur au Maroc à cette époque ne coupait pas seulement les cheveux mais se transformait en chirurgien de circonstance, pour arracher une mauvaise dent ou pour pratiquer la circoncision des petits garçons. Souvent, il était aussi l’ami de la famille, comme l’était effectivement M. Lahbib. Lui aussi avait quitté avec sa famille Fès comme nous pour venir chercher une vie meilleure à Casablanca, la capitale économique. Il était un homme très doux et correspondait bien à son nom qui veut dire « l’aimé ».
Je suis le dernier garçon de mes parents, le plus délicat et le plus fragile parmi mes frères, et parmi mes sœurs aussi. Cette délicatesse semble avoir pris racine à ma naissance. Ma mère n’avait pas de montée de lait et elle avait dû me nourrir avec ce qu’on appelle « Srira ». C’est une sorte de tétine faite d’un morceau de tissu fin en coton qu’on appelle le « Hayati » et dans lequel, elle mettait de la mie de pain avec du sucre écrasé et un peu d’huile d’olive.
A chaque fois qu’elle me parlait de la circoncision, elle semblait être inquiète pour moi, elle m’embrassait sur la joue et passait tout de suite à autre chose, repoussant ainsi sa décision et mettant de côté son enthousiasme à organiser un tel événement, beau et important dans la vie d’un garçon musulman. Moi, je ne disais ni oui ni non et j’étais vraiment persuadé qu’on allait faire l’exception pour moi, et au pire me circoncire comme elle me disait avec de simples ciseaux en bonbon !
Quand j’étais entré dans ma sixième année, la situation était devenue pressante car plus elle retardait le moment de ma circoncision, plus j’allais avoir mal lors de l’opération, et surtout, moins j’allais croire à son idée des ciseaux en bonbon.
La tradition chez les familles fassies de classe modeste voulait que c’est une tante maternelle ou paternelle ou des amis proches, un peu plus aisés, qui prennent l’initiative de circoncire l’enfant à l’insu de ses parents. C’est ce qu’on appelait dans le langage populaire « Sarka », le vol. Ceci était surtout dû au fait de vouloir faire une bonne action et de dispenser les parents de certaines dépenses liées à la préparation de cet événement.
Dans notre grande famille, nous étions les seuls, avec ma demi-sœur et son mari, à avoir quitté Fès pour Casablanca quelques années plutôt. De ce fait, le respect de la tradition familiale ne pouvait être observée d’une manière optimale. Ma mère avait dû se contenter de cacher l’événement à mon père. C’est pour cela, elle avait invité notre famille de Fès à venir à Casablanca le même jour et sans mettre au courant mon père. Et moi, pour que mon père ne se doutait de rien, elle m’avait confié à ma demi-sœur afin que celle-ci me prépare et passer prendre le lendemain le coiffeur pour venir tous les trois chez mes parents.
En effet, j’avais passé la nuit d’avant chez ma demi-sœur Maria qui vivait avec son mari et ses enfants dans la Nouvelle Médina de Casablanca, non loin du quartier des Habous où notre coiffeur et ami était installé. Elle m’avait préparé un dîner soigné, j’avais droit à mes desserts préférés : des yaourts faits maison avec du foin séché d’artichauts sauvages et des oranges pelées, coupées en rondelles et parsemées de sucre en poudre et de la cannelle moulue.
J’avais également eu droit au rond de henné sur la paume de ma main droite, car c’était mon choix, je ne voulais pas de henné sur les paumes de mes deux mains. Au Maroc, le henné est souvent associé à un événement pendant lequel le sang va couler. La jeune fille doit en mettre la veille de ses noces, le mouton de la grande fête musulmane à la veille de son sacrifice et le petit garçon à la veille de sa circoncision.
Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner, nous nous étions dirigés, ma demi-sœur et moi, vers le salon du coiffeur. Ce dernier nous attendait de pied ferme, à notre arrivée, il avait fermé son salon et nous avions pris le bus n° 12 pour aller chez mes parents à Hay Mohammadi. Il était un grand monsieur qui portait toujours une djellaba blanche sur un costume noir de style européen. Pendant le trajet, il m’avait demandé plusieurs fois de lui rappeler mon prénom et de lui dire mon âge, il faisait semblant d’oublier pour me faire parler et me mettre en confiance.
Nous étions arrivés vers le coup de midi, il y avait beaucoup d’invités chez nous, mes tantes, mes oncles, du côté maternel et du côté paternel, avec leurs enfants et quelques voisins. Seul mon père était absent, il allait rentrer de son travail comme d’habitude vers les 13 heures passées.
Nous vivions dans un petit appartement mais souvent nous nous rendions service entre voisins. La dame qui habitait notre étage, seule avec son jeune garçon, nous avait prêté son appartement afin d’avoir plus d’espace. En général, chez les Marocains des milieux populaires, une chambre est réservée aux parents, elle est meublée d’un grand lit et une belle armoire. La seconde chambre et l’espace cuisine sont meublés d’une sorte de sommiers en bois sur lesquels sont disposés des matelas hauts d’une largeur de soixante-dix centimètres et qui bordent toute la pièce. La pièce principale est meublée d’une qualité meilleure que celle du hall d’entrée. Cette pièce jouait un double rôle : la journée c’est le salon, lieu d’accueil des visiteurs et le soir elle se transformait en dortoir pour tous les enfants, petits et grands. Mais nous avions tout de même, chacune et chacun une place attitrée.
Ma mère et ma grande sœur m’avaient emmené dans l’appartement de la voisine pour m’enfiler la tenue traditionnelle formée d’un Tchamir, une sorte de robe large afin de permettre de se déplacer avec une certaine aisance après l’opération, un gilet traditionnel qu’on appelle Jokha et qui est fait de mousseline bariolée avec des fils d’or, un chapeau rond vert brodé appelé Tarbouch et une paire de babouches de couleur jaune qu’on appelle Balgha. Ensuite, elles m’avaient emmené dans notre salon et m’avaient installé sur deux grands coussins près de notre ami, le coiffeur-chirurgien.
Ce dernier avait commencé par préparer son matériel et à ma vue de ses vrais ciseaux, j’avais commencé à avoir une grande peur et à regarder durement ma mère qui se cachait au loin. On m’avait raconté plus tard que la pauvre avait plongé ses pieds, au milieu des youyous des membres de la famille et des voisines, dans une bassine remplie d’eau glacée avec dedans une pièce de métal, tant elle souffrait pour moi. L’eau froide permettant de calmer les esprits et le métal symbolisant la force et l’endurance qu’il faut réunir pour résister à la peur et aux inquiétudes. Elle devait avoir une double douleur, celle de voir son fils chéri souffrir et celle de m’avoir menti tout ce temps.
Avant de me couper le petit bout de peau, Monsieur Lahbib avait tenu mon zizi avec une de ses mains et pour détourner mon attention, il m’avait demandé de regarder l’oiseau qui soi-disant était entré par la fenêtre. Le temps de lever mes yeux naïvement, c’était déjà fini, il ne restait plus qu’à désinfecter la coupure au mercurochrome et mettre du coton et un pansement autour du zizi.
Les moyens de la famille ne permettaient pas de faire de grandes festivités comme il était coutume de faire, surtout en milieu rural ou dans les petites villes. Je n’avais pas eu par exemple, droit au tour à cheval la veille, vêtu de mes beaux habits traditionnels. Mais le jour de l’évènement, j’avais reçu beaucoup de petits cadeaux et un peu d’argent de poche au milieu des youyous et des chants des femmes de la famille auxquels j’avais droit toute l’après-midi.
L’arrivée de mon père était émouvante pour tout le monde, il avait tout de suite compris et il était venu me consoler et me prendre en charge puisque j’avais déjà commencé à bouder ma mère, la traîtresse. La pauvre, j’avais ajouté à sa souffrance cette punition, je ne lui avais pas adressé la parole pendant une semaine, jour pour jour.
La première soirée était la plus difficile, je n’avais pas quitté mon père d’une semelle. Je m’étais abstenu de faire pipi toute l’après-midi par peur d’avoir mal. Mon père m’avait accompagné aux toilettes plusieurs fois en récitant sa formule magique : « psssss, psssss … ». Ce n’était qu’après plusieurs essais, que le soulagement était enfin venu. A ce moment-là, j’avais les larmes aux yeux à cause des picotements et de la douleur provoqués par le pipi chaud et salé sur la coupure encore fraîche.
C’était ainsi que j’avais découvert qu’un père pouvait avoir aussi de la tendresse et de l’attention pour ses enfants. Lahbib, ce chirurgien de circonstance, malgré sa bienveillance et sa douceur reconnues de tous, était resté un temps dans mon esprit comme une épouvante.
Azeddine Sefrioui
6 novembre 2022
Une expérience de plus de 26 ans dans la gestion et le développement de sites Web, l’administration de bases de données, la gestion de projets informatiques et la formation des utilisateurs. Diplômé et formé dans les domaines de l’informatique, des sciences de l’information, des techniques documentaires, de l’administration des entreprises, des techniques d’écriture et de la psychologie.
Derniers articles
- Entrepreneur-e-s : Le guichet unique de l’INPI et la Signature qualifiée, une solution alternative à France Connect + 14 mai 2024
- Rachid Taha, sortie de l’intégrale de ses chansons en un coffret 5 janvier 2024
- Nass El Ghiwane 28 septembre 2023
- Solidarité avec le peuple marocain – Solidarité avec le peuple libyen 25 septembre 2023
- Les 10 romans marocains de langue française à ne pas rater 20 août 2023
Le Petit Maghreb
 lepetitmaghreb.fr est un portail à vocation commerciale et culturelle dédié à la communauté maghrébine établie en France, en Belgique et en Suisse francophone et à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à cette communauté.
lepetitmaghreb.fr est un portail à vocation commerciale et culturelle dédié à la communauté maghrébine établie en France, en Belgique et en Suisse francophone et à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à cette communauté.